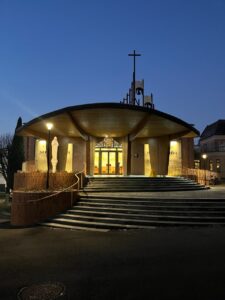«Jubilé» est le nom d’une année particulière: il semble dériver de l’instrument utilisé pour en indiquer le début; il s’agit du yobel, la corne de mouton, dont le son annonce le Jour de l’Expiation (Yom Kippour). Cette fête a lieu chaque année, mais elle prend une signification particulière quand elle coïncide avec le début de l’année jubilaire. On en retrouve une première idée dans la Bible: il devait être convoqué tous les 50 ans, car c’était l’année «supplémentaire», à vivre toutes les sept semaines d’années (cf. Lv 25,8-13). Bien que difficile à réaliser, il était proposé comme l’occasion de rétablir le rapport correct avec Dieu, entre les personnes et avec la création, et impliquait la remise des dettes, la restitution des terres aliénées et le repos de la terre.
En citant le prophète Isaïe, l’évangile selon St. Luc décrit ainsi aussi la mission de Jésus: «L’Esprit du Seigneur est au-dessus de moi; c’est pourquoi il m’a consacré par l’onction et m’a envoyé porter aux pauvres l’annonce heureuse, à proclamer aux prisonniers la libération et aux aveugles la vue; à remettre en liberté les opprimés, à proclamer l’année de grâce du Seigneur» (Lc 4, 18-19 ; cf. Is 61,1-2). Ces paroles de Jésus sont également devenues des actions de libération et de conversion dans le quotidien de ses rencontres et de ses relations.
Boniface VIII en 1300 a convoqué le premier Jubilé, également appelé «Année Sainte», parce que c’est un temps où l’on expérimente que la sainteté de Dieu nous transforme. La cadence a changé au fil du temps: au début, tous les 100 ans; elle est réduite à 50 ans en 1343 par Clément VI et à 25 ans en 1470 par Paul II. Il y a aussi des moments «extraordinaires» : par exemple, en 1933, Pie XI a voulu rappeler l’anniversaire de la Rédemption et en 2015, le pape François a lancé l’Année de la Miséricorde. La manière de célébrer cette année a également été différente: à l’origine, elle coïncidait avec la visite aux Basiliques romaines de Saint Pierre et de Saint Paul, puis avec le pèlerinage, par la suite d’autres signes ont éété ajoutés, comme celui de la Porte Sainte. En participant à l’Année Sainte, on vit l’indulgence plénière.
Une démarche jubilaire se vit avec un esprit de foi, une adhésion filiale à Dieu, une conversion réelle du coeur, le souci de construire autour de soi un monde plus humain et plus fraternel, le fait de se mettre en route afin d’effectuer un passage, celui de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière.
L’Eglise propose sept signes jubilaires distincts et complémentaires.
- Le Pèlerinage

Le jubilé demande de se mettre en marche et de franchir certaines frontières. Lorsque nous bougeons, en effet, nous ne changeons pas seulement un lieu, mais nous nous transformons nous-mêmes. C’est pourquoi il est important de se préparer, de planifier le trajet et de connaître la destination. En ce sens, le pèlerinage qui caractérise cette année commence avant le voyage lui-même: son point de départ est la décision de le faire. L’étymologie du mot «pèlerinage» est très éloquente et a subi peu de cangements de sens. Le mot, en effet, vient du latin per ager qui signifie «à travers les champs», ou per eger, qui signifie «passage de frontière»: les deux racines rappellent l’aspect distinctif d’entreprendre un voyage.
Abraham, dans la Bible, est décrit ainsi, comme une personne en chemin: « Quitte ton pays, ta parenté et de la maison de ton père» (Gn 12,1), avec ces mots commence son aventure, qui se termine dans la Terre Promise, où il est décrit comme «araméen errant» (Dt 26,5). Dana la même lignée, le ministère de Jésus s’identifie à un voyage à partir de la Galilée vers la Ville Sainte: «Alors qu’ils accomplissaient les jours où il serait élevé en haut, il prit la ferme décision de se mettre en chemin vers Jérusalem» (Lc 9, 51). Il appelle lui-même les disciples à parcourir cette voie et encore aujourd’hui les chrétiens sont ceux qui le suivent et se mettent à sa suite.
Le parcours, en réalité, se construit progressivement : il y a plusieurs itinéraires à choisir, des lieux à découvrir; les situations, les catéchèses, les rites et les liturgies, les compagnons de voyage permettent de s’enrichir de nouveaux contenus et perspectives. La contemplation de la création fait également partie de tout cela et elle est une aide pour apprendre combien en prendre soin «est une expression essentielle de la foi en Dieu et de l’obéissance à sa volonté» (François, Lettre pour le Jubilé 2025). Le pèlerinage est une expérience de conversion, de changement de son existence pour l’orienter vers la sainteté de Dieu. Avec elle, on fait aussi sienne l’expérience de cette partie de l’humanité qui, pour diverses raisons, est obligée de se mettre en route pour chercher un monde meilleur pour elle-même et pour sa famille.
- La Porte Sainte

Du point de vue symbolique, la Porte Sainte prend une signification particulière: c’est le signe le plus caractéristique, car le but est de pouvoir la franchir. Son ouverture par le Pape constitue le début officiel de l’Année Sainte. À l’origine, il n’y avait qu’une seule porte, à la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui est la cathédrale de l’évêque de Rome. Pour permettre aux nombreux pèlerins d’accomplir le geste, les autres Basiliques romaines ont également offert cette possibilité.
En passant ce seuil, le pèlerin se souvient du texte du chapitre 10 de l’Évangile selon Jean: «Je suis la porte: celui qui entre à travers moi, il sera sauvé; il entrera et sortira et trouvera le pâturage». Le geste exprime la décision de suivre et de se laisser guider par Jésus, qui est le Bon Pasteur. D’ailleurs, la porte est aussi un passage qui introduit à l’intérieur d’une église. Pour la communauté chrétienne, ce n’est pas seulement l’espace du sacré, auquel s’approcher avec respect, avec des comportements et avec des vêtements appropriés, mais c’est un signe de la communion qui lie chaque croyant au Christ: c’est le lieu de la rencontre et du dialogue, de la réconciliation et de la paix qui attend la visite de chaque pèlerin, l’espace de l’Église comme communauté des fidèles.
À Rome, cette expérience se charge d’une signification spéciale, pour le renvoi à la mémoire de Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres qui ont fondé et formé la communauté chrétienne de Rome et qui, par leurs enseignements et leur exemple, sont une référence pour l’Église universelle. Leur sépulcre se trouve ici, où ils ont été martyrisés; Avec les catacombes, c’est un lieu d’inspiration continue.
- Réconciliation

Le jubilé est un signe de réconciliation, car il ouvre un «temps favorable» (cf. 2Co 6,2) pour sa propre conversion. Dieu est mis au centre de sa propre existence, se déplaçant vers Lui et en reconnaissant sa primauté. L’appel au rétablissement de la justice sociale et au respect de la terre, dans la Bible, naît également d’une exigence théologique: si Dieu est le créateur de l’univers, il faut lui reconnaître priorité par rapport à toute réalité et par rapport aux intérêts partisans. C’est Lui qui rend cette année sainte en donnant sa sainteté.
Comme le rappelait le pape François dans la bulle d’indiction de l’année sainte extraordinaire de 2015: «La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. […]. Cette justice de Dieu est la miséricorde accordée à tous comme une grâce venant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La Croix du Christ est donc le jugement de Dieu sur chacun de nous et sur le monde, puisqu’elle nous donne la certitude de l’amour et de la vie nouvelle.» (Miséricordieux Vultus, n. 21).
Concrètement, il s’agit de vivre le sacrement de la réconciliation, de profiter de ce temps pour redécouvrir la valeur de la confession et recevoir personnellement la parole du pardon de Dieu. Certaines églises jubilaires offrent cette possibilité de manière continue. Tu peux t’y préparer en suivant un schéma.
- Prière

Il y a de nombreuses façons et de nombreuses raisons pour prier; à la base il y a toujours le désir de s’ouvrir à la présence de Dieu et à son offre d’amour. La communauté chrétienne se sent appelée et sait qu’elle ne peut s’adresser au Père que parce qu’elle a reçu l’Esprit du Fils.
Et c’est en effet, Jésus qui a confié à ses disciples la prière du Notre Père, également commentée par le Catéchisme de l’Église catholique (CCC 2759-2865). La tradition chrétienne offre d’autres textes, comme l’Ave Maria I (Je vous salue Marie), qui aident à trouver les mots pour s’adresser à Dieu: «C’est par une transmission vivante, la Tradition, que, dans l’Église, l’Esprit Saint enseigne aux enfants de Dieu à prier» (CCC 2661).
Les moments de prière accomplis pendant le voyage montrent que le pèlerin a les voies de Dieu «dans son cœur» (Ps 83,6). C’est à ce titre que sont prévus les moments de répit et de pause prévus dans les différentes étapes, souvent fixées autour de boutiques d’articles religieux, de sanctuaires, ou d’autres lieux particulièrement riches du point de vue spirituel, où l’on s’aperçoit que – auparavant et à ses côtés – d’autres pèlerins sont passés et que des chemins de sainteté ont parcouru ces mêmes routes. En effet, les voies qui mènent à Rome coïncident souvent avec le chemin de nombreux saints.
- Liturgie

La liturgie est la prière publique de l’Eglise : selon le Concile Vatican II, elle est le «point culminant vers lequel tendre» toute son action «et, en même temps, la source d’où provient toute son énergie» (Sacrosanctum Concilium, 10). Au centre de tout, il y a la célébration eucharistique, où l’on reçoit le Corps et le Sang du Christ: en tant que pèlerin, il marche lui-même aux côté des disciples et leur révèle les secrets du Père, afin qu’ils puissent dire: «Reste avec nous, parce que le jour baisse et le soir approche» (Lc 24, 29).
Un rite liturgique, caractéristique de l’Année Sainte, est l’ouverture de la Porte Sainte: jusqu’au siècle dernier, le Pape commençait plus ou moins symboliquement à démolir le mur qui le scellait. Ensuite les maçons enlevaient complètement les briques. Depuis 1950, le mur est démoli auparavant et, lors d’une liturgie chorale solennelle, le Pape pousse les battants de la porte de l’extérieur, et passe comme premier pèlerin à travers elle. Cette expression et d’autres qui accompagnent l’Année Sainte soulignent que le pèlerinage jubilaire n’est pas un acte intime, individuel, mais qu’il est le signe du chemin de tout le peuple de Dieu vers le Royaume.
- Profession de Foi

La profession de foi, également appelée « symbole », est un signe de reconnaissance propre des baptisés; on y exprime le contenu central de la foi et on recueille synthétiquement les principales vérités qu’un croyant accepte et témoigne le jour de son baptême et partage avec toute la communauté chrétienne pour le reste de sa vie.
Il existe plusieurs professions de foi, qui montrent la richesse de l’expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Traditionnellement, cependant, ceux qui ont acquis une reconnaissance particulière sont deux: le credo baptismal de l’église de Rome et le credo de Nicée-constantinople, élaboré à l’origine en 325 par le concile de Nicée, dans l’actuelle Turquie, puis perfectionné dans celui de Constantinople en 381.
« En effet, si tes lèvres confessent que « Jésus est Seigneur » et si ton cœur croit que Dieu l’a ressuscité des morts’, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut.» (Rm 10,9-10). Ce texte de Saint Paul souligne que la proclamation du mystère de la foi exige une conversion profonde non seulement dans ses propres paroles, mais aussi et surtout dans sa propre vision de Dieu, de soi-même et du monde. «Réciter avec foi le Credo, c’est entrer en communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c’est entrer aussi en communion avec l’Église toute entière qui nous transmet la foi et au sein de laquelle nous croyons» (CCC 197).
- Indulgence
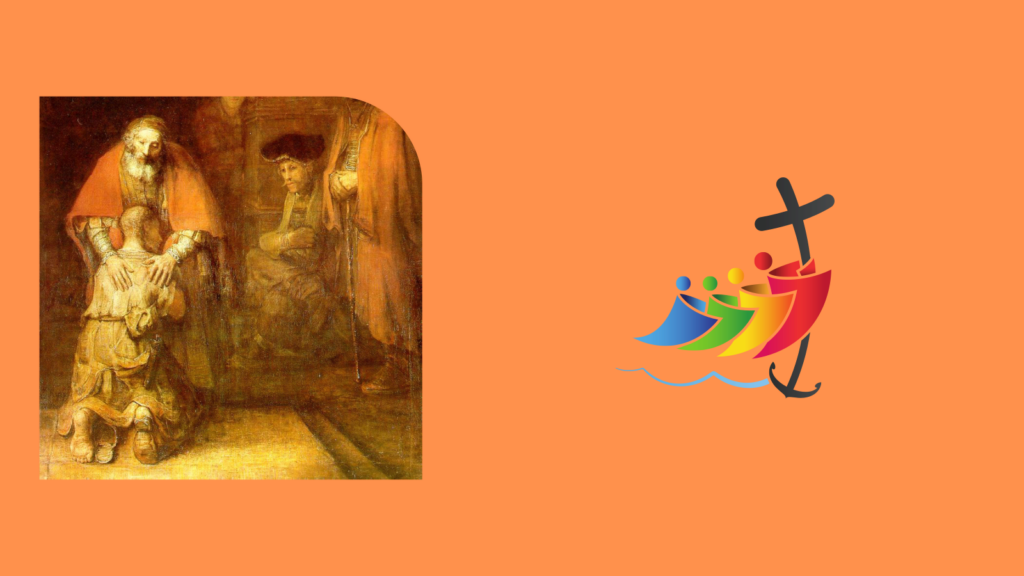
L’indulgence est une manifestation concrète de la miséricorde de Dieu, qui dépasse les limites de la justice humaine et les transforme. Ce trésor de grâce s’est fait histoire en Jésus et dans les saints: en regardant ces exemples et en vivant en communion avec eux, l’espérance du pardon et le chemin de sainteté se renforcent et deviennent certitude. L’indulgence permet de libérer son cœur du poids du péché, pour que la réparation due soit donnée en toute liberté.
Concrètement, cette expérience de miséricorde passe par certaines actions spirituelles qui sont indiquées par le Pape. Ceux qui, par maladie ou autre, ne peuvent pas se faire pèlerins sont cependant invités à prendre part au mouvement spirituel qui accompagne cette Année, en offrant leur souffrance et leur vie quotidienne et en participant à la célébration eucharistique.